
Rome, 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. La Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario, qui sont comme frères et soeur. Israel, le propriétaire du cirque et leur père putatif, tente d’organiser leur fuite à tous, à travers l’océan, mais il disparaît, et les quatre personnages sont soudain complètement perdus. Sans personne pour les assister, et surtout sans le cirque, ils n’ont plus leur place dans la société et se sentent comme des phénomènes de foire dans une ville en guerre.
Lightning show
Ce que la majorité des super-héros américains n’ont plus, c’est ce que l’italien Gabriele Mainetti (On l’appelle Jeeg Robot) récupère pour en faire un mélange détonant et particulièrement rafraîchissant. Avec Nicola Guaglianone au scénario, le cinéaste ne cache pas son envie de grandiose et il faudra peu de temps pour s’en rendre compte et lui donner toutes ses chances dans une aventure maline et parfois crues. On pourrait alors penser à « The Suicide Squad » de Gunn, à raison, mais ici, on préférera rebondir sur la sensibilité typiquement italienne, afin de révéler et de justifier la monstruosité, elle-même au service d’une réflexion intime et historique. L’Italie se tourne vers les heures sombres de l’occupation nazi, à Rome, nœud des rencontres et séparations improbables. C’est dans ce contexte que les héros évoluent, avec panache et dans la naïveté qui les contraignent à user de leur pouvoir pour la survie de tous.

Mais avant d’ouvrir sur les hostilités, place au freak show, place à une ouverture dans l’antre même où l’étrangeté apparaît comme une délivrance, voire une seconde chance, envers la différence. Sous le chapiteau, quatre fantastiques individus nous sont présentés à tour de rôle, dans un élan commun et dont les prestations s’avèrent complémentaires. Mais voilà que la guerre fait irruption avant même qu’ils ne se retirent. C’est la Seconde Guerre mondiale, les obus pleuvent sur leur foyer et leur public, nous sommes brutalement ramenés à la réalité, qu’il convient de combattre et d’accepter ses termes. La fantaisie possède ses limites et les nazis ne semblent pas prêts à laisser d’autres tentatives d’évasion se propager dans leur dos. La troupe de monstres fuit alors vers l’inconnu, où ils devront repenser leur façon de vivre et d’exploiter leur pouvoir pour gagner leur prune. Pourtant, c’est un sentiment familial qui se dégage du collectif, au premier abord dysfonctionnel.

Israel (Giorgio Tirabassi) agit en patriarche lucide et porte ses protégés vers l’ultime indépendance souhaitée. Mais sans ce guide, chacun fait face à ses contradictions. Le trio Fulvio (Claudio Santamaria), Cencio (Pietro Castellitto) et Mario (Giancarlo Martini) est indissociable. Ils seront servis à la même sauce tout le long de l’intrigue et on n’hésitera pas à piétiner leur mental. Cela ne sera sans doute pas suffisant pour les briser, car on les laisse un certain temps en retrait, afin de se concentrer sur la quête qui anime la jeune et électrisante Matilde (Aurora Giovinazzo). C’est à travers son parcours que le spectateur sera convié à prendre position, derrière de nobles principes, interrogeant sur la radicalité de la violence et autres arrestations arbitraires, jusqu’à un aller simple pour une rafle. Nous avons là une fille qui ne cesse de cultiver la solitude, imposer par ce qu’elle considère comme une malédiction. Le parallèle avec l’instabilité de l’adolescence n’est pas une nouveauté, mais ce qu’il faut retenir, c’est bien l’ode à la communion, la confiance et la solidarité, enjeu nettement suffisant et bien équilibré face à des ennemis qui ne cherchent qu’à tout contrôler et à tout diviser.

Portons un instant le regard vers Franz (Franz Rogowski), dont la prescience et la difformité le condamnent à rester un artiste, au lieu de se joindre à l’effort de guerre. Chacun recherche la reconnaissance, lui plus que quiconque, et ce, malgré sa vision pessimiste de ses semblables monstres, qui ne sont que de la chair à canon ou un moyen de justifier le voyeurisme mal placé à leur égard, sur une scène, où il n’y a que le spectacle qui compte. Cela en fait un antagoniste fort d’esprit, mais qui peut également succomber à l’appel de la normalité, qui le trahit forcément dans ses choix et dans les réponses qui lui viendront tout droit d’un smartphone, oui oui. Du « Freaks » de Tod Browning au « Inglourious Basterds » décérébré de Tarantino, en passant par la case esthétique de Guillermo Del Toro, bien entendu, Mainetti fait de son « Freaks Out » un sanctuaire précieux pour le cinéma européen, qui peut également rêver et aspirer à son propre folklore, loin de l’influence aseptisé des studios hollywoodiens et de leurs héros inoffensifs. La surprise est assez grande pour qu’on en souligne la grâce et l’orfèvrerie, qui ne demandent qu’à briller aussi longtemps que possible.

Retrouvez également ma critique sur :
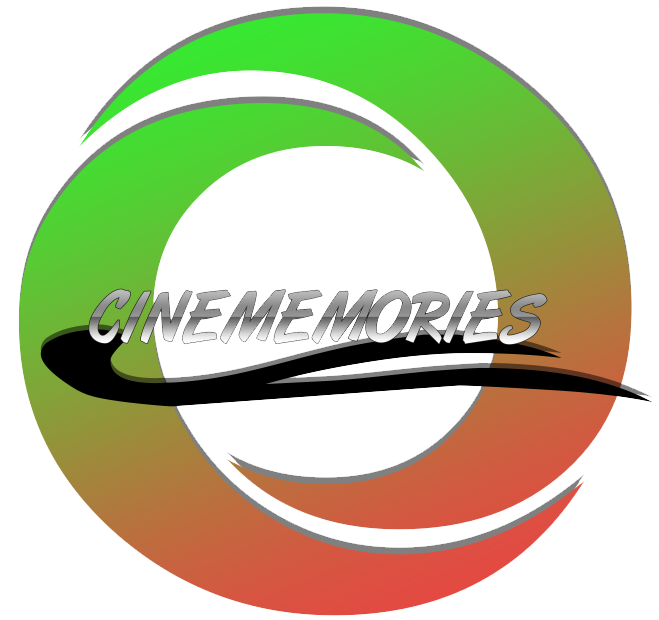







Laisser un commentaire