
Joan, épouse fidèle du célèbre auteur Joe Castleman, accompagne son mari à Stockholm où il doit recevoir le prix Nobel de littérature. Or dans l’avion, elle comprend petit à petit qu’après de longues années de vie commune, elle ne le supporte plus. Pourquoi ? Le passé et les rancœurs ressurgissent alors. Devra-t-elle briser leur secret au risque de tout perdre ?
L’art d’exister
Plutôt inspiré par les enjeux sociaux, le suédois Björn Runges reprend un filon qui n’est plus méconnu du public. Un couple au bout de son parcours, aboutit vers les conflits du passé, là où l’amour demeure presque insoluble dans un récit qui ne porte en rien le fardeau de l’originalité. Cependant, l’adaptation du roman éponyme de Meg Wolitzer peut susciter un intérêt là où le spectacle prendra forme autour de l’actrice vedette. Une famille se déchire et des personnalités en profitent pour s’affirmer. Nous pourrions nous attendre à une redite platonique, mais le registre pathétique change toute la donne.

Joe Castleman (Jonathan Pryce) est un écrivain, proche d’un Prix Nobel qu’il ne convoite pas, malgré ses talents. Le doute sur l’approche pédagogique du vieil homme se résume dans des flashbacks plutôt bien rythmés, mais qui ne repose pas toujours dans la subtilité. On en reprocherait une mise en scène trop théâtrale, bien que cela puisse convenir à cette épopée tragique. À ses côtés, Joan est campée par une Glenn Close très présente et très ambiguë. Ainsi, la complexité de son mari lui confère un certain crédit qu’elle ne gaspille pas en paroles inutiles. Chaque discours soulève une volonté de justice et d’amour, car sa condition de femme ne l’a pas aidé à tracer elle-même son chemin. Elle se cramponne à Joe, comme Joe pour sa carrière et une coalition est née, instinctivement. Ils repoussent les limites romanesques, sans en changer les codes, mais ce sera bien entendu dans la rancœur qu’il y aura matière à débattre.

La mère et le fils David (Max Irons) essayent tous deux de se frayer un chemin au milieu d’un parcours chaotique d’un père, qui a vraisemblablement failli en tant qu’époux, en tant que père et en tant qu’écrivain. L’inspiration n’y est plus, il ne surfe que sur une vague d’opportunités qu’il revendique par fierté ou par nécessité. Son esprit torturé soutient alors une morale d’imposture qui sera maintes fois exploitée, sous diverses formes. Or, l’interprète de Joan nous livre une performance exceptionnelle, car on en comprend tout ce qu’elle a pu accumuler de bien et de mal dans sa tête. Mais peut-être bien que la pertinence de son jeu nous atteigne, car il s’agit d’un portrait de femme révoltée, comme on en voit souvent sur les écrans dernièrement. En réalité, elle frappe juste, mais sans plus, comme si elle s’est conditionnée pour une certaine récompense qui lui ironiquement tend la main, car un duo s’effectue à deux par définition et ce tandem n’est pas à négliger.

La famille Close a bien eu son mot à dire dans cette intrigue qui laisse un parfum de mystère derrière elle. Adoubant ainsi les performances de la mère et de sa fille Annie Starke, « The Wife » catapulte de grands rôles féminins au sein d’un système qui ne met en avant que la testostérone, quel que soit le domaine d’application. Il faudra une lecture lente et distraite afin d’équilibrer les échanges, là où le gagnant ne recevra ni trophée, ni satisfaction.

Retrouvez également ma critique sur :
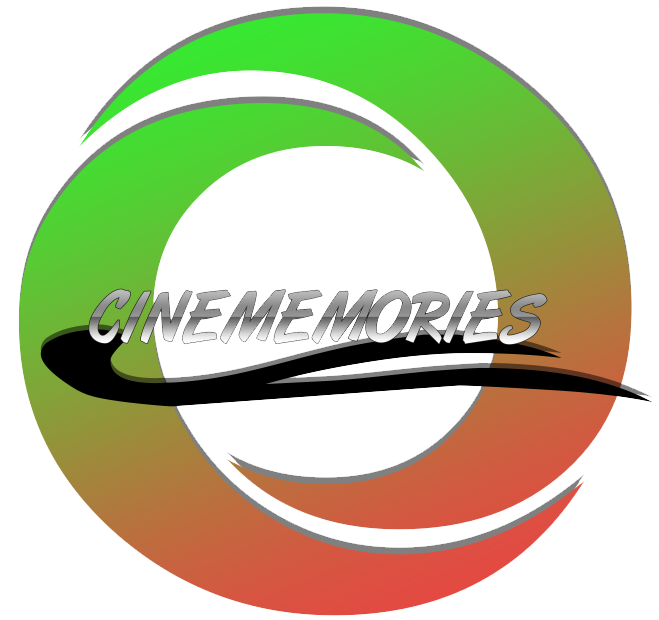







Laisser un commentaire